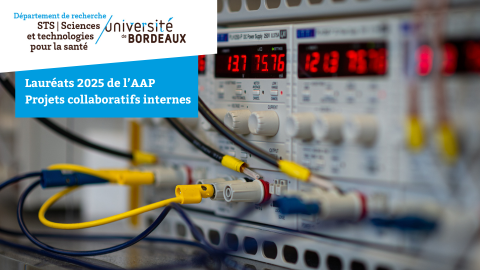Jeanne Leblond Chain est chercheurse au laboratoire ARNA (Acides nucléiques : Régulations naturelles et artificielles). Elle est lauréate avec Isabelle Dupin, enseignante-chercheuse au CRCTB (Centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux), de l'AAP projets collaboratifs 2023 du Département Sciences et Technologies pour la Santé.
- Pourriez-vous présenter en quelques mots votre parcours et vos thématiques de recherche ?
Je m’appelle Jeanne Leblond Chain, je suis chercheur Inserm au sein du laboratoire Acides Nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA).
J’ai commencé ma carrière à l’université de Montréal d’abord en tant que post-doc pour un contrat de 4 ans puis comme professeur de 2011 à 2018. C’est en 2019 que j’ai rejoint ARNA et l’équipe ChemBioPharm dont je dirige actuellement le groupe de recherche « Targeted Aptamers, Medicines and Sensing ».
Chimiste de formation, j’ai fait tout mon parcours en sciences pharmaceutiques. Je me suis spécialisée sur la question de la vectorisation de médicaments et d’acides nucléiques ainsi que sur leur ciblage. Autrement dit, je mets au point des procédés pour transporter un médicament au site d’action et pour qu’il aille spécifiquement dans les tissus ciblés et non dans les tissus sains. Je vérifie également si ce ciblage permet de réduire les effets secondaires des médicaments.
- Vous êtes lauréates de l’AAP STS 2023 projets collaboratifs avec Isabelle Dupin, chercheur Inserm au Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB). Cet AAP a vocation à financer des travaux innovants menés conjointement entre deux unités membres du département. Pouvez-vous en dire un peu plus sur les travaux que vous menez avec Isabelle Dupin et qui vous ont amenées à être financées par STS ?
Le projet que le département nous a aidé à financer vise à proposer une thérapie par des acides nucléiques pour la « Bronchite Pulmonaire Chronique Obstructive » (BPCO). La recherche thérapeutique sur cette pathologie est au cœur des travaux d’Isabelle Dupin dont le laboratoire se consacre notamment à l’étude des maladies inflammatoires du poumon.
LA BPCO est une maladie multifactorielle, dont on n’identifie pas encore très bien les causes. Il n’existe pas de traitement à l’heure actuelle. Les malades n’ont accès qu’à des médicaments qui allègent leurs symptômes mais ne les guérissent pas.
Dans la recherche thérapeutique sur la BPCO, un des enjeux majeurs est dans un premier temps de comprendre comment elle fonctionne. Une des innovations du projet que nous menons est de tenter de repérer quelles protéines éteindre au sein des cellules ciblées pour empêcher l’expression de la pathologie puis de trouver un moyen efficace de les neutraliser.
Dans cette perspective, Isabelle Dupin a initié l’étude d’acides nucléiques interférents, qu’on appelle « Small Interfering RNA » (siRNA), spécifiques pour identifier les protéines à cibler dans cette maladie (dans un premier temps) et pour développer une thérapie (dans un deuxième temps). Ces siRNA sont des petits acides nucléiques double brin d’environ 20 paires de bases qui ont pour principal effet de diminuer l’expression d’une protéine dans des cellules ciblées. La question ici est de savoir quel siRNA utiliser et comment le transporter jusqu’à la cible. Ce transport s’avère être la principale difficulté car les siRNA se dégradent très facilement une fois injectés dans l’organisme.
C’est à cette étape que j’interviens pour mettre au point une vectorisation afin de transporter le siRNA jusqu’à la cible. A cette fin, je développe des nanoparticules qui permettent de les encapsuler, de les transporter de façon stable dans le sang et de les livrer dans le cytoplasme de la cellule ciblée. Cette technologie est relativement connue. Elle reprend les mécanismes qui ont été utilisés et approuvés cliniquement dans le traitement d’une maladie rare du foie. Elle consiste plus précisément à vectoriser le siRNA dans une nanoparticule lipidique qui ressemble beaucoup à celle qui a été utilisée dans le vaccin contre le Covid. L’avantage de cette méthode est notamment la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut changer d’acides nucléiques ce qui permet de multiplier les essais sur le modèle cellulaire de la BPCO qu’Isabelle Dupin a constitué dans son laboratoire.
Interview d'Isabelle Dupin sur le site d'information Curieux live sur la BPCO
Dernière mise à jour :
Le modèle d’étude utilisé est très beau. Des cellules issues de patients sont cultivées in vitro afin de reconstituer l’épithélium d’un patient. Grâce à ce modèle de cellules primaires, il n’est plus nécessaire de travailler avec des souris ce qui est un excellent point. Cependant l’ensemble des échantillons récupérés ne sont pas nécessairement atteints par la BPCO ce qui engendre une grande variabilité dans le modèle. En effet il est difficile d’obtenir des prélèvements cellulaires de patients atteints par la BPCO, nous réalisons donc nos études sur des échantillons à différents degrés d’évolution de la maladie. La BPCO étant une maladie avec des grades très variés, il s’agit d’une pathologie très difficile à modéliser. Pour contrer cette problématique, une technologie innovante de modèle 3D est développée au CRCTB. Les chercheurs reconstituent des bronches in vitro et tentent d’induire la maladie via notamment de la fumée de cigarettes (voir article Isabelle Dupin UB/Curieuxlive). Actuellement notre étude est basée sur un modèle 2D, des épithéliums, et nous prenons en compte ce biais dans l’analyse de nos résultats mais nous avons comme projet de travailler sur ce modèle 3D.
- Quand vous avez commencé vos recherches avec Isabelle Dupin, vous aviez quelques pistes ?

Lorsque nous avons soumis le projet à l’AAP projet collaboratif interne du département, nous avions déjà des résultats préliminaires encourageants. Nous avions pu montrer qu’en injectant par voie intraveineuse à une souris des nanoparticules lipidiques contenant des siRNA spécifiques, nous parvenions à éteindre des protéines sur d’autres systèmes. L’intérêt de cette technologie, par rapport à d’autres nanoparticules lipidiques, est que le lipide utilisé permet d’avoir une meilleure efficacité de libération du siRNA dans les cellules cibles. On parle d’une transfection. La transfection est le processus par lequel la nanoparticule entre dans la cellule et libère le siARN dans le cytosol pour qu’il trouve l’ARNm complémentaire et le neutralise, l’empêchant de synthétiser la protéine ciblée. Dans ce processus, les lipides constituant la nanoparticule ont un rôle très important pour s’associer avec les membranes cellulaires puis s’en départir pour libérer le siARN. Celui que j’ai développé améliore la quantité de siARN qui est livré dans le cytosol.
Le défi avec la BPCO et que l’on change complètement de cadre. Nous passons au traitement d’une maladie du poumon et nous devons développer un produit qui ne se délivre pas en intraveineuse mais nébulisé par voie pulmonaire, sous forme de spray. En résumé, pour ce projet, nous nous confrontons à un autre modèle et devons développer un autre siRNA et une autre technologie pour sa vectorisation jusqu’aux cellules cibles.
Du côté technologique, les nanoparticules lipidiques sont en partie efficaces cependant les cellules des patients sont très difficiles à pénétrer. Pour traiter ce problème, j’ai proposé à Isabelle Dupin d’utiliser des aptamères, technologie développée au sein du laboratoire ARNA, qui permet de reconnaître les cellules pulmonaires atteintes de BPCO et d’augmenter la pénétration des nanoparticules. La première partie du projet a consisté à développer un aptamère capable de se fixer spécifiquement aux cellules cibles puis à les fixer sur les lipides de nos nanoparticules. L’ajout de ces aptamères à la surface des nanoparticules leur permettra, in fine, de livrer davantage de siRNA.
En ce qui concerne le siRNA, l’enjeu a été de déterminer quelles protéines participant à l’expression de la maladie nous devons éteindre puis de produire le siRNA correspondant. C’est qui est la seconde partie du projet.
- Et aujourd’hui, où en êtes-vous ?
Nous avons bien avancé sur ces deux parties.
Un étudiant en stage de Master 2 nous a aidé à décorer nos nanoparticules lipidiques avec des aptamères. Nous sommes parvenus à trouver le récepteur cellulaire qu’il fallait cibler. Nous avons identifié un aptamère. Nous avons validé qu’il reconnaissait bien sa cible puis nous l’avons greffé sur une nanoparticule lipidique. Pour finir, nous avons comparé l’internalisation des nanoparticules avec ou sans l’aptamère en question.
Nos résultats ont été mitigés, nos nanoparticules rentrent très bien dans nos cellules immortalisées de poumon. Toutefois, quand nous les avons testées sur les modèles cellulaires de nos patients, nous n’avons pas détecté un niveau d’internalisation optimal. Notre hypothèse principale pour l’expliquer est que les cellules de patients sur lesquelles nous travaillons sont très variables, comme je le mentionnais. Les cellules que nous récupérons ne sont pas forcément celles de patients atteints par la BPCO et nous ne pouvons pas vérifier l’expression des récepteurs que nous souhaitons exploiter patient par patient. Nous ne sommes donc pas sûrs que, sur notre échantillon, le récepteur soit surexprimé. Autre piste : notre priorité est de trouver le modèle adapté à notre récepteur, et de montrer que notre stratégie fonctionne avec ce récepteur, comme preuve de concept, c’est-à-dire que l’on peut améliorer la quantité de siRNA livrée grâce aux aptamères. Ensuite, nous pourrons la transposer pour un autre récepteur assez facilement.
La communication dans les projets mobilisant plusieurs disciplines est vraiment fondamentale. Il faut parvenir à trouver un terrain commun pour être aussi capable de s’exprimer et de donner son avis sur l’ensemble des enjeux du projet conduit en interdisciplinarité. C’est la condition pour créer des collaborations interdisciplinaires saines, fructueuses et constructives.
Du côté de l’identification du siRNA, nous avons là aussi bien avancé. Au moment du projet, nous avions fait juste une preuve de concept avec des siRNA fluorescents qui allumaient les cellules dans lesquelles ils étaient rentrés. Nous utilisons maintenant un siRNA qui vise une des potentielles cibles non encore validées de cette maladie. C’est un facteur de transcription dont nous supposons qu’il est impliqué dans la différenciation des cellules. Lorsque nous faisons pousser des cellules nous obtenons des cellules ciliées avec des cils qui battent et font bouger le mucus pour l’évacuer des bronches, et des cellules qui sécrètent du mucus. Les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire produisent beaucoup de mucus ce qui est à la fois protecteur des cellules mais également dommageable. Non seulement la production abondante de mucus ne permet pas aux médicaments d’accéder aux cellules mais en outre le mucus est un nid à bactéries. Si nous parvenons à réguler la production de ce mucus, nous reviendrons à des conditions normales pour le fonctionnement optimal du poumon. Nous avons donc essayé avec ce facteur de transcription de cibler les cellules en gobelet, cellules épithéliales spécialisées dans la sécrétion de mucus, afin de réduire leur population permettant ainsi de diminuer le mucus. Nous avons bien avancé sur ce point mais les recherches sont encore en cours. Nous avons réussi à réduire le facteur de transcription, mais pas à montrer que cela réduisait le nombre de cellules en gobelet. La question est de savoir si cela est assez significatif pour induire un effet satisfaisant sur la production de mucus. Pour l’instant la réponse est non, ce n’est pas démontré.

Notre hypothèse est que pour que ce procédé soit efficace, il doit avoir lieu avant la différenciation des cellules. Or, dans notre modèle cellulaire, les cellules sont déjà bien différenciées et donc il n’y a plus la place pour qu’elles se remultiplient et se redifférencient. Il faudrait donc, sans doute, changer les conditions pour vérifier si cela fonctionne de manière satisfaisante. En résumé, nous avons une preuve de concept sur ce facteur de transcription : nous sommes parvenus à identifier un siRNA pertinent qui rentre bien dans les cellules et qui éteint bien les protéines que nous avions ciblées. La vectorisation marche donc bien. Par contre nous ne pouvons pas encore démontrer l’efficacité du procédé sur le modèle actuel. Malgré tout, cela reste des avancées significatives qui nous ont permis d’obtenir de nouveaux financements pour poursuivre nos travaux.
Plusieurs personnels ont travaillé sur le projet. Un étudiant en Master 2 à ARNA ainsi qu’une post-doctorante au CRCTB, qui a été intégrée dans la collaboration, puis une assistante ingénieure qui a repris la culture des cellules primaires et qui travaille actuellement sur le projet au CRCTB.
Depuis que nous collaborons avec Isabelle Dupin, nous avons eu aussi à cœur de communiquer sur l’avancée de nos travaux en congrès, en séminaires et sous forme de posters notamment à l’international en Belgique et à Singapour.
- Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le financement obtenu suite à l’AAP projet collaboratif de STS ?
Les résultats obtenus dans le cadre de la collaboration soutenue par le Département, nous ont permis d’obtenir un financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Cela démontre donc qu’il y a bien un effet levier des AAP mis en place par le Département.
Avant de formaliser la collaboration, nous avons fait quelques expériences préliminaires pour voir comment ça se passait et si ça pouvait donner quelque chose. Nos équipes se sont très bien entendues, c’est aller très vite, c’était facile : tous les signaux étaient ainsi au vert pour construire une collaboration scientifique fructueuse.
Pour cette ANR, nous avons gardé quasiment le même projet (en particulier la partie ciblage). Nous avons simplement ajouté un axe sur l’amélioration de la pénétration dans le mucus des nanoparticules afin qu’elles soient en capacité de se frayer un chemin jusqu’aux cellules épithéliales. Pour faire cela, nous travaillons en collaboration avec un laboratoire de Montpellier qui développe des polymères qui nous intéressent. La collaboration avec Montpellier se fait également sur un autre aspect du travail. Si nous voulons dans un premier temps développer une forme nébulisée (spray) pour le traitement de la BPCO, nous cherchons à terme à mettre au point un procédé d’administration du médicament sous forme de poudre sèche, similaire au procédé utilisé pour la Ventoline, qui est plus acceptée par le patient. En effet, le spray nécessite que les malades reçoivent le traitement via une machine pendant une demi-heure. C’est plus doux mais c’est aussi beaucoup plus lourd. Nous aimerions donc transformer nos nanoparticules en poudre. Or Marie Morille, enseignante-chercheuse à l’Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM), possède l’expertise pour opérer cette transformation. Nous envisageons aussi de tester d’autres siRNA. Enfin, si nous arrivons jusqu’au modèle 3D développé par le CRCTB, on sera vraiment content ! Le financement ANR nous a également permis d’embaucher, à partir d’octobre 2024, une doctorante, Viet-Ha Phan, qui vient du Vietnam et que nous avons recrutée ensemble avec Isabelle Dupin. Elle avait un profil plutôt chimie mais avec une appétence pour la biologie ce qui était un critère important pour nous. Elle travaille principalement à ARNA actuellement mais elle sera également amenée à travailler au CRCTB dès que nous serons prêts à passer au modèle primaire.
En résumé c’est vraiment un projet passionnant !
- Comment vous vous êtes rencontrées avec Isabelle et comment tout cela a commencé ?
Nous nous sommes rencontrées à Bordeaux à une journée microfluidique qui était une initiative unique organisée autour de Jean-Christophe Baret, chercheur CNRS au Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP). Il s’agissait d’une journée « partage d’expériences » entre chercheurs du site bordelais travaillant en microfluidique. Isabelle y avait présenté le travail de son équipe sur les organoïdes, recherche qu’elle mène en collaboration avec la plateforme VoxCell (TBMCore). Cette plateforme multidisciplinaire propose d’associer la technologie microfluidique des capsules cellulaires et la biologie pour former des sphéroïdes ou organoïdes tumoraux à haut rendement. Quant à moi, j’étais venus car je prépare des nanoparticules par microfluidique. Donc, de prime abord, on ne faisait pas du tout les mêmes choses. Toutefois, suite à nos présentations respectives, nous avons commencé à échanger. Son modèle cellulaire m’avait particulièrement intéressée et parallèlement les siRNA avaient retenu l’attention d’Isabelle qui souhaitait les tester car ils ouvraient des pistes prometteuses et jamais explorées pour le traitement de la BPCO. Avant de formaliser la collaboration, nous avons fait quelques expériences préliminaires pour voir comment ça se passait et si ça pouvait donner quelque chose. Nos équipes se sont très bien entendues, c’est aller très vite, c’était facile : tous les signaux étaient ainsi au vert pour construire une collaboration scientifique fructueuse.
- Et en quoi ce projet poursuit l’ambition pluridisciplinaire du département STS ?
Notre projet est vraiment un mélange entre chimie, physico-chimie, biochimie, biologie moléculaire, bio-conjugaison, physiopathologie, biologie cellulaire, …
On a vraiment des expertises différentes ce qui n’est pas toujours évident. Pour que ça marche, il faut faire en sorte de créer un cadre de communication sain entre équipes. C’est cela qui a fait que notre projet a bien fonctionné : la communication était simple, nos équipes ont vraiment fait l’effort de parler science entre elles tout en faisant attention à se créer un langage commun sans utiliser les mots très spécifiques à nos domaines respectifs. On a vraiment construit une vraie collaboration honnête. La communication dans les projets mobilisant plusieurs disciplines est vraiment fondamentale. Il faut parvenir à trouver un terrain commun pour être aussi capable de s’exprimer et de donner son avis sur l’ensemble des enjeux du projet conduit en interdisciplinarité. C’est la condition pour créer des collaborations interdisciplinaires saines, fructueuses et constructives.
- Et pour finir, les AAP projets collaboratifs du département, une initiative à maintenir à l’avenir ?
Oh oui ! C’est vraiment important comme dispositif. Pas simplement d’ailleurs pour la somme d’argent que nous recevons si notre projet est sélectionné mais aussi parce que ça nous booste. Cela nous donne de la motivation et de l’énergie pour se concentrer pendant un an sur un projet car être lauréat nous montre que des gens croient en notre travail. Il se joue vraiment là d’ailleurs l’effet levier !
Decouvir les autres AAP internes du départements STS
-

Participation à des manifestations scientifiques
Le Département STS souhaite encourager les jeunes chercheurs (doctorants dans...
-

Participation à la mobilité
Le Département STS souhaite encourager les jeunes chercheurs (doctorants dans...
-

Organisation de manifestations scientifiques
Le Département STS souhaite renouveler son dispositif de soutien pour l’organ...
-

Ateliers technologiques
Cet AAP souhaite apporter son soutien à la création d’ateliers technologiques...
-

Equipements mutualisés
Cet AAP vise à apporter un soutien aux équipements mutualisés qui sont au ser...
-
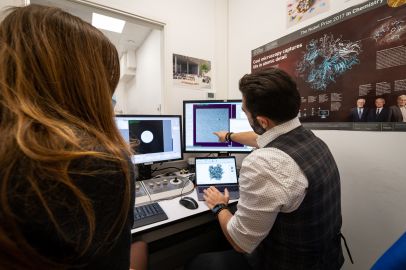
Mobilités entrantes courte durée
Le Département STS souhaite soutenir les mobilités entrantes de chercheur.es/...
Interview réalisée par Jean-Michel Blanc et Clémence Faure
Crédits photo - Clémence Faure, département STS, université de Bordeaux / Jeanne Leblond Chain (ARNA) et Isabelle Dupin (CRCTB)