Poste : Chargée de recherche
Lieu : Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB), campus Carreire, 50 personnes
Employeur : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Arrivée : Chargée de recherche depuis 2014, au CRMSB depuis 2014
Personnel : Chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA

Emeline Ribot est chargée de recherche CNRS au CRMSB depuis 10 ans. Elle revient ici sur ce qui fait la spécificité du métier de chercheur. Elle partage son goût pour les manips, son intérêt pour la médiation scientifique et son investissement pour le département STS.
Au service de la science et de la connaissance, elle parle aussi de ses travaux en IRM quantitative et de ce qu'elle espère pouvoir apporter par ses recherches lors de diagnostics ou de suivis de traitements thérapeutiques des patients.
-
En quoi consiste le métier de chargé de recherche ?
Les chargés de recherche, comme l'ensemble des chercheurs, ont vocation à faire avancer la connaissance scientifique.
A cette fin, nous concevons, organisons et réalisons des expérimentations pour tester nos hypothèses de recherche. Nous créons des collaborations avec d'autres chercheurs, en France et ailleurs, pour faire circuler les savoirs et améliorer nos méthodes d’imagerie. Nous communiquons nos résultats et nos découvertes à la communauté scientifique pour que nos collègues discutent nos travaux, s'en emparent, les répètent et les améliorent à leur tour pour leur application spécifique. Enfin, nous transmettons notre science et nos méthodes aux étudiants et, en particulier, aux doctorants et aux post-doctorants que nous encadrons afin qu'ils se forment et nous aident à faire progresser la recherche.
Pour que tout cela soit possible, nous devons, et c'est là un autre aspect de notre métier, nous tenir à jour sur l'actualité scientifique en lien avec nos sujets. Notre travail consiste donc aussi à faire de la veille bibliographique et à suivre régulièrement des formations sur diverses thématiques. Nous avons des formations obligatoires, comme par exemple, dans mon domaine, la nécessité de maintenir à jour nos connaissances en expérimentation animale. Nous avons aussi la liberté de nous former à d'autres dimensions de nos activités comme le management, les risques psycho-sociaux ou encore le montage de projet et cela afin que tout se passe bien dans nos équipes comme dans nos projets.
Si nous arrivons à accroitre la qualité des images produites via les IRM bas champ, cela permettrait à des pays et des structures qui n'ont pas les moyens de se doter d'IRM puissants d'accéder quand même à cette technique améliorant par là-même le suivi et la prise en charge thérapeutique des patients.
Enfin, une part importante du métier est consacrée à la recherche de financements. Cela devient de plus en plus crucial, voire vital pour certains d'entre nous, vu que les dotations de nos tutelles ne cessent de diminuer. Sans financement pas de matériel, pas de manip, pas d'étudiant, et donc inévitablement la recherche ralentit. Trouver des moyens s'avère donc un impératif et implique de multiplier les candidatures aux appels à projets ouverts par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), la Région ou encore la Commission Européenne.
-
Dans la pratique, quelles sont vos missions au quotidien ?
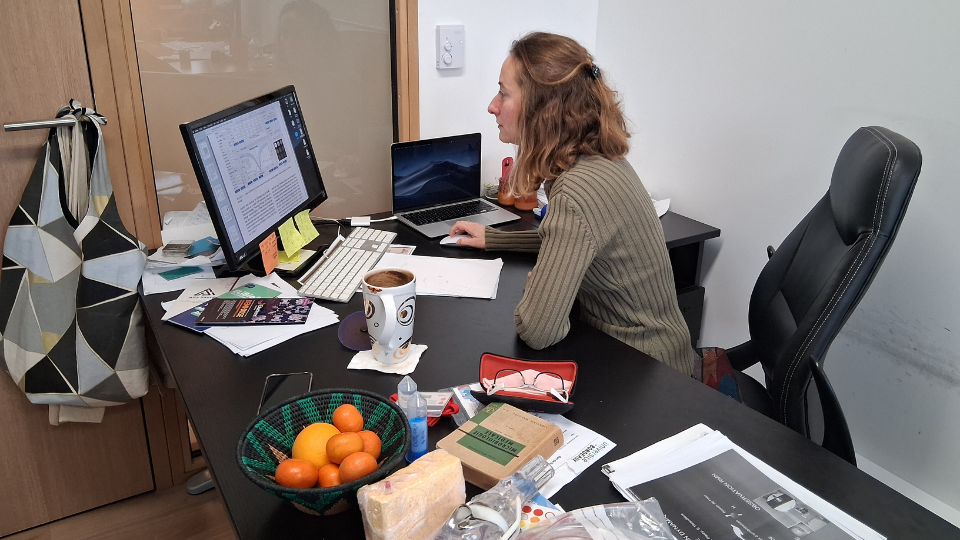
Au sein du CRMSB, je suis directrice d’une équipe de 20 personnes. A côté de mes travaux de recherche (manip, écriture d'articles, communications scientifiques...) je dois donc assurer au quotidien l'animation d'un groupe. Concrètement, je suis chargée de suivre les budgets qui lui sont alloués. Je sollicite régulièrement mes collègues afin qu'ils me transmettent les bilans financiers de leurs projets en cours. Je fais aussi des points réguliers avec Véronique Champfay, la gestionnaire de notre laboratoire. Je vérifie également que tous les membres de mon groupe ont les moyens de travailler dans de bonnes conditions (ordinateurs, matériels, bureaux). J'assure aussi le suivi RH (avancements, besoin de recrutements, de prolongations...). Enfin, j'ai des tâches de représentation - je participe au comité du laboratoire et je publie les actualités de l’équipe sur notre site internet - et de communication puisqu'il me revient de faire le lien entre la direction et les membres de mon équipe.
En plus de ces activités de recherche et de ces tâches de direction, je consacre aussi une partie de mon temps à vulgariser mes travaux auprès du grand public. C'est à la fois par goût mais aussi parce qu'aujourd'hui, quand on bénéficie d'un financement européen ou ANR, on doit utiliser une part du budget pour faire de la médiation scientifique. Au début, j'avoue, on n'a pas forcément envie de se rajouter encore des activités dans un calendrier qui est déjà très contraint. Mais finalement on se prend au jeu et on réitère l'expérience de nous-mêmes ! C'est vraiment une autre manière de transmettre nos savoirs. C'est une démarche enrichissante et gratifiante et ça nous aide en retour à parler autrement de nos travaux.
En 2023, j'ai participé pour la première fois au circuit scientifique bordelais. Plus récemment, j'ai animé un atelier avec Cap Sciences à destination des collégiens et des lycéens. Ils sont venus au labo, je leur ai présenté ce que c'était que l'IRM, les différentes techniques d'imagerie et ils ont pu voir une personne se faire scanner. C'était vraiment super ! Ils posent plein de questions et nous font prendre conscience que certains sujets qui sont évidents pour nous, ne le sont pas forcément pour tout le monde. Je ne sais pas encore si cela leur a plu mais moi je me suis beaucoup amusée ! Cela m'a aussi aidée à parler de mes recherches d'une manière à ce qu'elles soient comprises par le plus grand nombre et plus uniquement par mes collègues scientifiques. J'ai également eu la chance d'être interrogée par les Dealers de science, l'association des masters « Médiation et communication des sciences et des techniques » (MCST) de l’université Bordeaux Montaigne.
Nous sommes plusieurs au CRMSB à nous engager sur ces actions grand public. Des collègues ont participé à la Nuit européenne des chercheurs. Sylvain Miraux, le directeur de l'unité, et Laurence Dallet, ingénieure biologiste à la plateforme d’imagerie bio-médicale (URA3767), sont allés dans les collèges pour présenter le métier de scientifique. Bientôt, dans le cadre d'un projet ANR que j'ai obtenu en 2019, et avec l'aide du service SAPS (Science avec et pour la société) de l'université de Bordeaux, je vais faire une bande dessinée sur mes travaux de recherche !
Enfin, je siège au Conseil du département STS, ainsi qu'au Comité d’éthique pour l’expérimentation animale de Bordeaux. Ce comité a pour mission de valider au niveau de l'établissement les projets qui sollicitent une expérimentation animale. Les dossiers qu'il reçoit sont transmis à des groupes d'experts qui vérifient si les procédures sont bien respectées, si les gestes qui sont prévus sont nécessaires et respecteux du bien-être animal, ou encore si le nombre d’animaux demandés est justifié. Il y a vraiment un contrôle très strict. Les demandes qui sont validées par ces experts puis par le comité d'éthique local sont ensuite envoyées au Ministère pour validation finale.
[Ndlr - pour en savoir plus sur l'éthique de la recherche en expérimentation animale, voir l'article sur le site de l'université]
- Quelles études avez-vous faites pour devenir chargée de recherche et quel est votre parcours professionnel ?
Après mon Baccalauréat, j'ai fait deux ans en classe préparatoire dans le but de rentrer dans une école d'ingénieur agronome. J'ai été acceptée dans deux écoles mais je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai donc changé de voie et suis partie à l'université de Bordeaux pour m'inscrire en licence biologie cellulaire et physiopathologie (BCPP). J'ai ensuite passé ma maitrise, puis mon DEA sous la direction d'Anne-Karine Bouzier-Sore, directrice de recherche CNRS au CRMSB. J'ai poursuivi en thèse, dans le même laboratoire, sous la direction de Pierre Voisin, chercheur émérite en biochimie. C'est au cours de mon doctorat que j'ai découvert l'IRM et que j'ai eu envie de me spécialiser dans ce domaine. Je n'ai pas abandonné la biologie mais j'ai axé principalement mes travaux de recherche sur l'IRM pour répondre à des questions en biologie. Une fois docteure, j'ai été recrutée comme post-doctorante à London en Ontario, Canada pour travailler en onco-imagerie sur le petit animal. Après 4 ans au Canada, je suis revenue à Bordeaux pour un post-doc de 2 ans au CRMSB. C'est au bout de ces deux années et après quatre campagnes, que j'ai eu le concours CNRS et que j'ai intégré, comme chargée de recherche, le laboratoire.
- Quels sont les aspects que vous aimez le plus dans votre métier ?
Ce que j'affectionne particulièrement dans mon métier c'est la polyvalence autant scientifique - je travaille en physique de l'IRM mais je fais aussi de la biologie, je travaille sur le petit-animal et sur l’homme - que dans les types d'activité (formation, RH, bien-être au travail...). Ne pas être cantonnée à une seule tâche ou à un seul champ disciplinaire, c'est vraiment enrichissant. On touche à tout, du coup on s'ouvre à plein de domaines et on rencontre plein de gens.
- Rencontrez-vous parfois des difficultés dans votre travail ?
Cela peut s'avérer quelque fois compliqué de jongler avec toutes ces activités et de ne pas avoir en conséquence une semaine trop chargée. Ce qui me plaît particulièrement dans mon travail de chercheuse, ce sont les manips. Comme je veux continuer à en faire, j'essaye toujours de me garder du temps dans mon emploi du temps pour en caler. Toutefois, avec la direction de mon équipe et toutes les autres missions liées à la recherche que je mentionnais, ce n'est pas toujours simple.
Quand je demande aux étudiants de me scanner pour tester ce qu'on développe au sein de l'équipe, cela me berce et résultat: je m'endors !
L'autre aspect qui est un peu pesant pour tout le monde, c'est la recherche de financements. Cela prend beaucoup de temps et ce n'est pas systématiquement couronné de succès donc ça peut être un peu déprimant parfois.
- Et dans 10 ans, où vous voyez-vous ?
Toujours ici, dans ce labo ! Il y a une bonne ambiance et une bonne entraide au CRMSB. Et aussi beaucoup échanges ! Mon bureau se trouve devant la cuisine donc souvent les gens s'arrêtent pour discuter. J'aime beaucoup ça. On a même mis un tableau dans mon bureau pour que les collègues me montrent sur quoi ils travaillent et on se retrouve finalement à en parler à 3/4 autour de mon bureau! C'est très agréable.
Aussi, j'aimerais que mes travaux soient utilisés dans le monde entier et que ça serve ! Ca me plairait que ce que ce que je fais dans mon labo, dans mon petit coin, soit réutilisé partout et que cela aide à améliorer la prise en charge des patients. Mes recherches visent à améliorer la qualité des images obtenues par IRM. Quand une personne passe un IRM, selon la position qu'elle prend et/ou si elle bouge durant le scan, l'image pourra être plus ou moins précise. D'autres facteurs peuvent venir également biaiser les images comme la variation de température ou les mouvements physiologiques comme la respiration, etc. Ainsi les images actuelles peuvent être floues, et par conséquent l’examen doit être répété. Mes travaux sur ce que l'on appelle l'"IRM quantitative" consiste à développer des méthodes pour mesurer des paramètres physiques de l’eau que nous avons dans le corps, de s'affranchir de l'ensemble de ces aléas afin d'obtenir des images de qualité, et tout ça sans rallonger le temps de l’examen. In fine, cela permettrait d'améliorer à la fois le confort du patient et la précision du diagnostic. Récemment, nous avons créé des collaborations avec des mathématiciens spécialistes d'intelligence artificielle, car cela nous permettrait à la fois de raccourcir le temps d'acquisition des données et de récupérer une bonne qualité d'image.

C'est d'autant plus intéressant pour nous au CRMSB, qu'avec le nouvel institut hospitalo-universitaire (IHU VBHI) qui est à côté, nous avons décidé de tenter de démocratiser l’IRM, en utilisant entre autre des IRM à bas champ magnétique. La tendance aujourd'hui est d'aller vers de l'IRM de plus en plus performante qui intègre des aimants toujours plus puissants. Ces IRM produisent des images très fines qui permettent de voir des très petites choses. C'est une innovation importante mais son inconvénient est qu'elle coûte très chère. De notre côté, nous avons décidé de nous concentrer à l'inverse sur des IRM qui utilisent des aimants avec un champ magnétique faible : les IRM "bas champ". De fait, cela les rend non seulement plus économiques mais aussi plus écologiques. Leur défaut par contre est de produire des images moins bien résolues (des pixels plus gros) et plus bruitées (avec beaucoup de grains), et donc moins précises. Avec mon groupe, nous allons travailler, notamment avec l'IA, à améliorer la qualité des images obtenues via ce type de machine. Si nous arrivons à accroitre la qualité des images produites via les IRM bas champ, cela permettrait à des pays et des structures qui n'ont pas les moyens de se doter d'IRM puissants d'accéder quand même à cette technique améliorant par là-même le suivi et la prise en charge thérapeutique des patients. J'espère qu'on y sera parvenu d'ici 10 ans !
- Qu'est que le département STS vous apporte au quotidien ?
Pendant 4 ans, de 2019 à 2023, j'ai fait partie avec Jean-François Quignard, enseignant-chercheur au Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB), du groupe de travail animation du département. Cela m’a beaucoup plu. En particulier, j'ai aimé organiser des journées scientifiques à destination de la communauté STS. En plus, c'était la première fois que je montais ce genre d'événement. Ce que j'appréciais beaucoup c'était de créer les conditions optimales pour que les gens se rencontrent et échangent en ne se souciant de rien d'autres. Autrement dit, qu'ils puissent se concentrer, autant que faire se peut, sur la science. C'est vraiment gratifiant quand on y arrive. Maintenant que je ne fais plus partie de ce groupe de travail, j’aime encore aller aux journées scientifiques du département pour voir les avancées dans d’autres domaines scientifiques. Comme la communauté STS est très pluridisciplinaire, cela permet de se tenir à la page dans plein de champs différents, ce que j'affectionne beaucoup. Cela permet de rencontrer de nouveaux collègues, de faire naître, devant un poster, de nouvelles idées voire de nouvelles collaborations quand bien même celles-ci n'iraient pas jusqu'au bout. C'est super stimulant.
Si je ne suis plus au groupe animation, je reste quand même membre du conseil du département au sein duquel je siège depuis 2019. Cela me permet de connaître en avant-première les orientations politiques de l’université qui est une des tutelles du CRMSB. C'est important de se tenir au courant des décisions de la gouvernance au niveau des emplois, de comprendre les interactions avec les autres départements, de s'informer sur les nouveaux programmes, de connaître et rencontrer les nouveaux interlocuteurs... C'est aussi l'occasion pour nous de faire remonter les difficultés que nous rencontrons par exemple sur les problèmes de locaux.
- Et pour terminer, une anecdote de recherche ?

Quand je demande aux étudiants de me scanner pour tester ce qu'on développe au sein de l'équipe, cela me berce et résultat je m'endors ! En plus avec le casque dans lequel on peut diffuser de la musique, cela ne m'aide pas à rester éveillée. Et je suis loin d'être la seule à sombrer dans le sommeil dans les IRM ! Au GIN, ils ont fait une étude sur l'activité cérébrale au repos et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des résultats étranges sur toute une série de patients. Ils ont fini par comprendre qu'une partie de la cohorte s'était assoupie ! Cela produisait de fait des données inattendues car l'activité cérébrale est bien différente au repos et endormi.
Encadré - Série "Un métier, un portrait - dans les coulisses de la recherche"
Si la recherche est produite avant tout par les chercheurs, reste que pour lui permettre d'exister et de progresser, c'est tout un ensemble de personnels qui lui sont nécessaires. Du laborantin au gestionnaire administratif, du vétérinaire au personnel de laverie, en passant par les ingénieurs de recherche, les chargés de communication ou encore les project managers, ils sont nombreux et nombreuses à permettre à la science de se faire.
Afin de faire découvrir ces métiers et les personnes qui les font plus ou moins dans l'ombre, le département STS a lancé sa série "Un métier, un portrait - dans les coulisses de la recherche".
A lire ou à relire : le troisième épisode "Dans le cockpit de l'unité".
Interview réalisée par Alexandra Prévot et Clémence Faure
Crédits photo - Clémence Faure, département STS, université de Bordeaux / Gautier Dufau, université de Bordeaux




